retourner sur les bords
revenir à l’accueil/plan du site
pousser la porte du Montparnasse monde
passer chez l’historienne
passer dans l’Atelier 62
aller faire un tour chez L’employée aux écritures

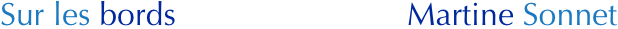
retourner sur les bords
revenir à l’accueil/plan du site
pousser la porte du Montparnasse monde
passer chez l’historienne
passer dans l’Atelier 62
aller faire un tour chez L’employée aux écritures
Je séjournais pour la première fois à Carrouges quand j’appris la mort de mon cher Jean-Jacques ; la triste nouvelle jeta son voile noir sur le plus délicieux des séjours. Ce début juillet de 1778, je visitais mon Henriette-Charlotte unie un mois plus tôt au vicomte Alexis Le Veneur et qui l’avait suivi sur ses terres. Curieuse de cette campagne normande collineuse et boisée, je m’empressai d’honorer l’invitation de mon gendre. Veuve, me refusant à nouer toute nouvelle alliance (même avec ce Monsieur de Margency, si proche du vivant du marquis de Verdelin, en faveur duquel notre ami commun Jean-Jacques intercédait), rien ne me retenait à Paris. La mort prématurée de ma fille aînée avait été suivie du mariage de Léontine et la troisième, à son tour, était ravie à mes yeux aimants par ce mari qui l’emmenait vivre dans sa campagne.
Je m’étais immédiatement plue à Carrouges et ragaillardie de l’air léger qu’on y respirait, sans songer encore à m’y établir tout à fait, comme je le ferai peu après aux fins d’assister ma fille dans le soin de ses enfants et de sa maison, son époux devant suivre son régiment. Mes premiers jours au château furent un véritable enchantement. Je découvrais, guidée par mes charmants hôtes, la sobre bâtisse entourée d’eau et son séduisant pavillon d’entrée. Tout m’y émerveillait : ses murs aux entrelacs de briques rouges et de briques noires, les ferronneries superbes (le domaine possédait ses forges au cœur de la toute proche forêt d’Ecouves), et ses jardins soignés que les jeunes gens rêvaient d’embellir encore.
Le soir, nous jouions dans le salon d’été, où des talents poétiques et musicaux se faisaient entendre, où des conversations de la meilleure tenue littéraire et philosophique se nouaient. L’harmonie régnant dans le couple, la gaieté et l’esprit qui l’animaient, rejaillissant sur la société assemblée autour de lui, auguraient que cette alliance porterait d’heureux fruits et que ma cadette jouirait en sa demeure d’une douce quiétude. Je n’avais pas élevé mes trois filles dans d’autres desseins, m’en remettant aux conseils éclairés du cher Jean-Jacques, notre voisin quand elles étaient petites. Lui vivait alors à Montmorency et nous autres à Soisy ; mon vieux mari, malade, avait élu ce havre de paix pour s’y retirer.
J’avais prié mes gens de me faire suivre à Carrouges le Journal de Paris et c’est ainsi que la funeste nouvelle qui brisa net ma félicité me parvint. Occupée à ma correspondance un matin dans ma chambre, entre deux lettres d’affaires je décachetais le Journal du dimanche 5 juillet qui venait de m’être porté, quand mes yeux se posèrent sur l’annonce sibylline que je dus lire maintes fois avant que son sens pénètre mon esprit et ravage mon coeur : On apprend dans l’instant que le célèbre Jean-Jacques ROUSSEAU, Genevois, vient de mourir dans la soixante-neuf ou dixième année de son âge à Armenonville, Village à onze lieues & demie de Paris, où il s’était retiré depuis environ trois semaines. Sept longues années, alors, que notre commerce épistolaire était rompu ; le cher homme enfoncé sans rémission dans son imagination trompeuse croyait le genre humain ligué contre lui, sans en excepter ses plus fidèles amis au nombre desquels je puis m’honorer d’avoir été. Indéfectiblement.
Page arrachée aux
MEMOIRES APOCRYPHES DE LA MARQUISE DE VERDELIN
juillet 1778
Ce texte a été écrit à propos du château de Carrouges, dans l’Orne, pour l’ouvrage
100 monuments 100 écrivains, histoires de France, publié en décembre 2009 par les Editions du patrimoine
